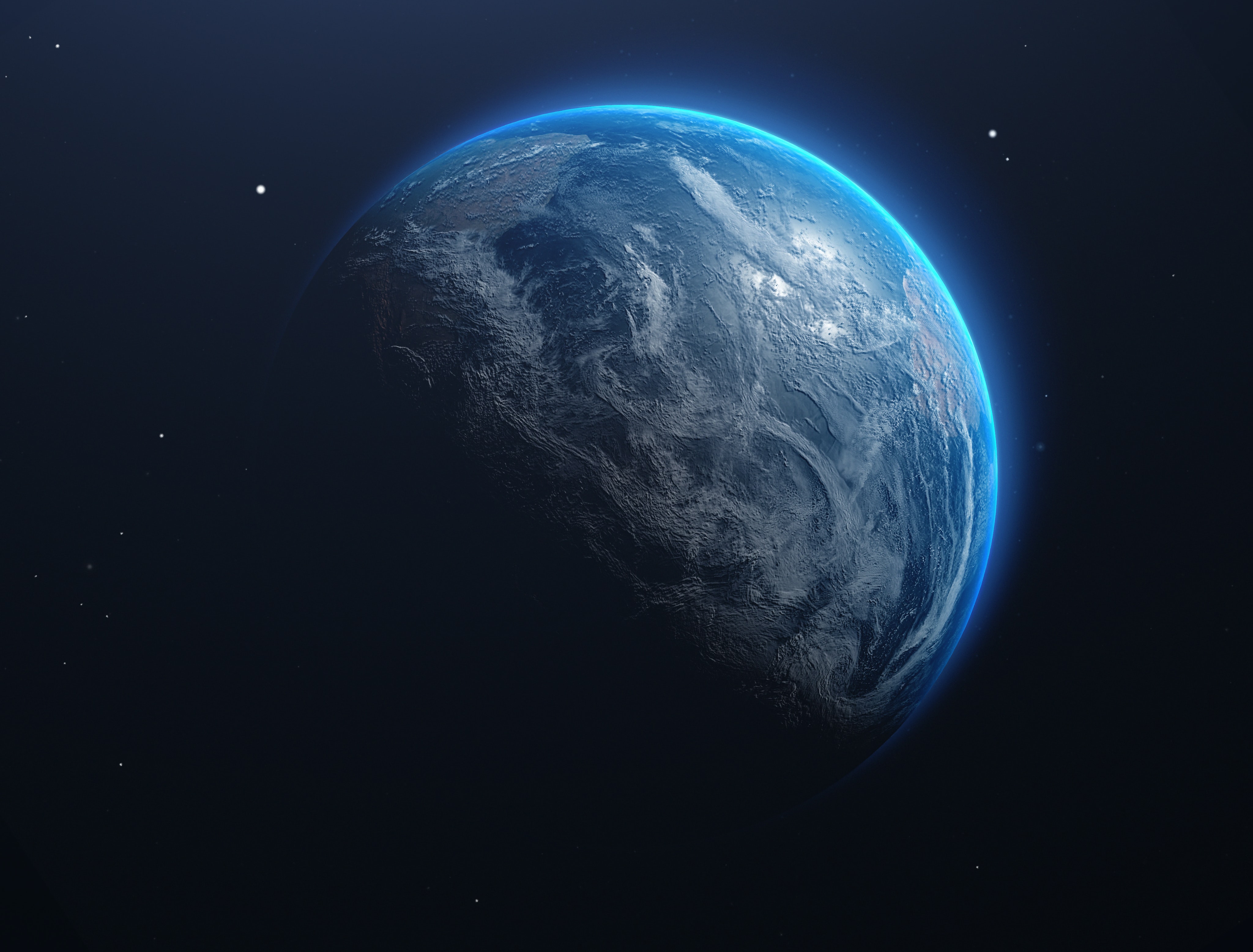Ce site a pour vocation de présenter, à titre posthume, les travaux de Guy Convert (1920-2022) réalisés en 2009 et 2010 concernant l'impact du CO2 sur le climat , et dont le contenu peut se résumer ainsi : « La façon dont sont présentés l'effet de serre et son mécanisme séduit par sa simplicité. La focalisation sur le dioxyde de carbone conduit à une image, non seulement étriquée, mais fausse, de la réalité du climat. Par ailleurs, du point de vue de la physique, en considérant le seul impact de ce gaz, une augmentation de la concentration en dioxyde de carbone entraîne un refroidissement de l'atmosphère et de la surface terrestre. »
Si, ces dernières années, plusieurs scientifiques dans le monde ont abouti à cette même conclusion, il semblait important de présenter les arguments scientifiques de Guy Convert et leurs fondements pour alimenter le débat.
Avertissement : il ne s'agit pas ici de donner un avis tranché sur le réchauffement ou le refroidissement climatique. Les travaux de Guy Convert se concentrent sur la critique de la notion d'effet de serre, sous un angle purement scientifique et non politique. Il s'agit simplement de publier la démonstration scientifique de Guy Convert et ses conclusions afin d'alimenter les discussions des scientifiques spécialistes des disciplines en lien avec le climat.
Guy Convert : travaux et publications
Guy Convert est un ingénieur-chercheur français. Premier prix du Concours général de Physique en 1939. Ancien élève de l'École Normale Supérieure, il devient Directeur du Laboratoire Central de Recherches de Thomson-CSF où il était entré en 1949.
Lire la suite...Ses travaux, publications et conférences en France et à l'international font de lui un scientifique renommé dont l'expertise est reconnue par ses pairs (récipiendaire de la médaille Blondel en 1963).
Tout au long de sa carrière, ses publications ont valeur de référence dans les domaines suivants : tubes électroniques (applications aux radars, relais hertziens…), plasmas (instabilités, diagnostic), électronique quantique (lasers), état solide (semi-conducteurs, composants pour circuits logiques et hyperfréquence), hyperthermie (traitement du cancer et de maladies vénériennes), théorie du Signal. Plus de détails : ici.
En 1981, il devient ingénieur-conseil indépendant pour poursuivre ses missions dans de nombreux domaines avec, entre autres, Thalès, l'institut Gustave Roussy, le CNRS, et continuera à travailler officiellement jusqu'à l'âge de 81 ans, officieusement jusqu'à ses 97 ans.
Rayonnement thermique et Thermodynamique
Résumé
Parmi les mécanismes de régulation de la température de l'atmosphère et de la surface de la Terre, le rayonnement thermique et ses supports, les gaz dits à effet de serre, jouent un rôle essentiel.
Un réchauffement provoque une augmentation de la concentration dans l'atmosphère, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du méthane, etc. Ces gaz, à leur tour, entraînent un accroissement du transfert entre rayonnement thermique et atmosphère, et par suite, une diminution des différends gradients de température qui existent entre eux. Il en résulte un refroidissement de la basse atmosphère et de la surface de la Terre.
Lire la suite...Interprétation
Les échanges d'énergie entre rayonnements électromagnétiques et matière peuvent se décrire d'une manière très simple et tout à fait conforme à notre intuition des phénomènes thermiques.
Ces échanges se produisent à des fréquences caractéristiques des éléments matériels. Suivant les travaux de Max Planck, on peut assigner une température à un rayonnement thermique dont la fréquence est donnée.
Dès lors, la description des échanges entre rayonnement et matière s'exprime d'une manière évidente. Un rayonnement froid se réchauffe (absorbe de l'énergie) en refroidissant un élément matériel plus chaud. Un rayonnement chaud réchauffe un élément froid en lui cédant de l'énergie.
La nécessité d'introduire les notions de rayonnement chaud et de rayonnement froid tient au fait qu'il ne peut y avoir d'échange direct entre deux ondes électromagnétiques ; leur couplage ne peut se faire que par leur interaction avec de la matière.
Cependant, dans tous les cas, les transferts de chaleur se font de corps chauds à corps froids et avec production d'entropie. Ces échanges manifestent la tendance à l'égalisation des températures entre éléments chauds et éléments froids conformément au deuxième principe de la thermodynamique.
Ce point de vue sur les échanges permet de mieux comprendre le rôle des gaz « à effet de serre » dans les transferts de chaleur de l'atmosphère. Un rayonnement chaud traversant une couche de gaz atmosphérique dont la température est plus basse, lui cède de l'énergie. Sa température décroit au cours de sa traversée, tendant à l'équilibre thermique avec le gaz. D'une manière analogue, un rayonnement froid, traversant une couche atmosphérique plus chaude, lui emprunte de l'énergie et tend également à l'équilibre avec elle. Cette tendance à l'égalisation des températures est fonction de la concentration en gaz à effet de serre, elle s'accroît lorsque la concentration augmente.
L'atmosphère
L'atmosphère terrestre peut se décrire comme formée de couches horizontales successives de températures décroissantes de la surface de la Terre au sommet de la troposphère.
La température d'un rayonnement issu de la Terre et traversant l'atmosphère est, quelle qu'en soit l'incidence, toujours plus élevée que celle des couches traversées : le rayonnement leur cède constamment de l'énergie.
Un rayonnement issu de l'espace (4°K) et dirigé vers la Terre traverse des couches plus chaudes, qui lui cèdent de l'énergie. Sa température au voisinage de la surface terrestre est, au plus, égale à celle du bas de l'atmosphère. C'est un rayonnement froid qui refroidit la Terre qui l'absorbe (la Terre cède en effet de l'énergie au rayonnement pour qu'il atteigne l'équilibre thermique avec elle).
Ainsi, les rayonnements qui traversent l'atmosphère de la Terre vers l'espace ou de l'espace vers la Terre tendent à égaliser les températures entre les différentes parties de l'atmosphère et entre la surface Terrestre et l'atmosphère.
En ce sens ce mécanisme ne diffère pas dans ses effets des phénomènes de conduction, convection, ou autres, qui régissent les transferts de chaleur de l'atmosphère.
Gradient de température
Une « Terre » et une « atmosphère » contenues dans une enceinte adiabatique doivent, d'après ce qui précède, se retrouver à la même température, que l'ensemble soit, ou non, sous l'action d'un champ de gravitation.
Mais la Terre et l'atmosphère ne constituent pas évidemment un système clos. La Terre reçoit du soleil, par rayonnement de l'énergie aux courtes longueurs d'ondes. Une quantité égale d'énergie, en moyenne est réémise en infra-rouge vers l'espace, directement par la Terre pour une petite part, et pour la plus grande part, au sommet de la troposphère. La température en cette région est déterminée par le niveau d'énergie à émettre.
Mais il ne peut y avoir de transfert net d'énergie dans une atmosphère à l'équilibre thermique. Par conséquent, la température des basses couches et de la terre doit être supérieure à la température de la zone d'émission pour y assurer le transfert d'énergie nécessaire.
Lorsque la concentration en gaz à effet de serre augmente, le gradient de température de l'atmosphère diminue. La température du sommet de la troposphère restant constante, la température de la basse atmosphère et de la surfa ce de la Terre doit baisser.
Conclusion
Il est très généralement admis, aujourd'hui, que l'augmentation de la concentration des molécules de gaz à effet de serre provoque un réchauffement de la surface terrestre.
La présentation qui précède aboutit à la conclusion contraire : augmenter la concentration de ces gaz doit diminuer l'écart de température entre sommet de l'atmosphère et surface terrestre et, par suite, abaisser la température de celle-ci.
Sur l'effet de serre
Les observations suivantes ont pour but de dégager les raisons du désaccord manifeste qui apparaît entre les conclusions précédentes et celles les plus généralement admises sur « l'effet de serre ».
Lire la suite...L'équation de transfert
Les calculs les plus complets sur les échanges d'énergie entre rayonnement et gaz à effet de serre utilisent, à des variantes près, une même « équation de transfert radiatif ». Cette équation établit le bilan des échanges dans chaque direction de l'espace et pour chacune des fréquences d'interaction. Elle est adaptée à la description des phénomènes en atmosphère « ciel clair », où la diffusion est négligeable.
Le bilan d'énergie s'y présente sous la forme d'une somme de deux termes. L'un concerne le rayonnement incident à l'entrée de la couche atmosphérique en interaction : il est présenté comme absorbé par les gaz à effet de serre. L'autre terme concerne le rayonnement propre de la couche, émis en sortie. Cette formulation est conforme à la loi de Kirchhoff qui exprime que « l'absorptivité » et « l'émissivité » d'un système à l'équilibre thermique sont égales entre elles. Elle permet de faire le calcul de l'énergie échangée avec un rayonnement traversant l'épaisseur de toute la couche atmosphérique ; mais, ce faisant, elle gomme la réalité physique « locale » de l'interaction.
Pour décrire un système thermodynamique complexe, un volume de gaz (composé de molécules et d'atomes), ou encore un rayonnement (composé d'ondes électromagnétiques élémentaires), il ne suffit pas de connaître son énergie totale, mais il faut encore connaître la répartition de cette énergie entre ses différents composants élémentaires. Il faut connaître, soit la température, soit l'entropie.
La notion de température de rayonnement permet de mieux comprendre la physique des échanges au niveau local. Entre rayonnement thermique et atmosphère les écarts de température sont relativement faibles. Sur une courte distance, la quantité de chaleur transférée de l'un à l'autre, à une fréquence donnée, peut être considérée comme proportionnelle à l'écart de température et à la concentration des gaz à effet de serre. L'énergie échangée va naturellement du corps chaud vers le corps froid.
Ce qui précède n'est pas n'est pas incompatible avec l'équation de transfert. Il suffit d'un simple réarrangement des termes de cette équation pour y faire apparaître l'échange à l'échelle locale. La notion de température y manque cependant.
Le bilan de l'atmosphère
Les calculs des transferts actuels d'énergie entre le rayonnement thermique et l'atmosphère supposent que les molécules de gaz à effet de serre restent localement en équilibre thermique avec les autres molécules et atomes. On distingue schématiquement plusieurs profils de température de l'atmosphère : régions équatoriales, régions tempérées, régions polaires.
Dans un profil moyen, la température de la surface terrestre est de 15°C. La température de l'atmosphère, plus faible, décroît lentement dans les basses couches, plus rapidement en altitude (de l'ordre de 6 à 7°C par km) jusqu'à la tropopause. Le ciel y est sans nuages. Pour les calculs, on distingue le rayonnement ascendant du rayonnement descendant.
Le rayonnement ascendant est formé de toutes les ondes élémentaires issues de la surface et qui traversent l'atmosphère sous des incidences diverses. Dans l'hypothèse le plus souvent admise où la surface terrestre est assimilée à un corps noir, toutes ces ondes ont initialement la même température, celle de la surface. Dans leur traversée de l'atmosphère, elles cèdent constamment de l'énergie. Leurs températures cessent d'être identiques, mais elles restent supérieures à celle du sommet de l'atmosphère. L'énergie rayonnée dans l'espace est ainsi inférieure à l'énergie émise par la surface terrestre. La différence entre ces deux quantités, l'énergie transmise à l'atmosphère, généralement notée G, est donnée comme une mesure de l'effet de serre.
Le rayonnement descendant, issu de l'espace, est un rayonnement froid. Dans sa traversée de l'atmosphère, il se réchauffe en absorbant constamment de l'énergie, mais sa température reste toujours inférieure à celle des couches traversées. Ce rayonnement refroidit la surface terrestre plus chaude que lui. L'énergie qu'il reçoit de l'atmosphère est supérieure à l'énergie fournie par le rayonnement ascendant. Le bilan des échanges d'énergie entre rayonnement thermique et atmosphère est clair : l'atmosphère fournit plus d'énergie au rayonnement qu'elle n'en reçoit de lui. L'ordre de grandeur est d'une centaine de W/m2. La capacité calorifique à pression constante d'une colonne atmosphérique d'un mètre carré de section est de l'ordre de 107 J/°K ; sans apport extérieur d'énergie, la température moyenne de l'atmosphère baisserait de l'ordre d'un degré en 24h.
La température de l'atmosphère est maintenue à son niveau par un apport d'énergie provenant pour l'essentiel de deux sources distinctes. D'une part, le retour des molécules d'ozone à l'état de molécules d'oxygène normales, pour approximativement 70W/m2; et, d'autre part, l'apport par la surface terrestre d'énergie par conduction thermique et surtout par convection et chaleur latente de vapeur d'eau. Il est difficile d'évaluer avec exactitude ces différents apports. Les calculs des énergies mises en jeu dans les échanges où intervient le rayonnement sont au contraire, semble-t-il, susceptibles d'être faits avec une grande précision. Clairement, la précision du chiffrage de ces différents effets paraît devoir beaucoup au souci d'aboutir, pour l'atmosphère, à un bilan d'énergie équilibré.
Croissance de la concentration du dioxyde de carbone
L'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre de l'atmosphère favorise le transfert d'énergie entre l'atmosphère et le rayonnement thermique. Plus précisément, en chaque point de leurs régions d'interaction les écarts de température entre rayonnements et atmosphère doivent décroître.
L'attention se porte tout particulièrement sur le dioxyde de carbone, en raison des mécanismes de réactions positives qui lui sont associés.
Il est clair que, si l'on suppose que la température de l'atmosphère et son profil restent constants lorsqu'augmente la concentration en gaz carbonique, l'énergie cédée par le rayonnement ascendant, toujours plus chaud que l'atmosphère dans sa traversée, augmente. C'est ce que montre le calcul ; le coefficient G, donné comme mesurant l'effet de serre, augmente, l'énergie rayonnée au haut de l'atmosphère diminue. Suivant le raisonnement généralement admis, la température de la surface terrestre doit augmenter pour qu'augmente l'énergie émise.
Cependant, lorsque la concentration du gaz carbonique augmente, le rayonnement froid descendant, est couplé plus étroitement à l'atmosphère, et, dans l'hypothèse de calcul du paragraphe précédent, l'énergie qu'il en reçoit augmente. Localement, l'écart de température entre les rayonnements ascendant et descendant diminue, marquant la tendance à l'uniformisation des températures. Au total, le déficit en énergie de l'atmosphère dans ses échanges avec le rayonnement augmente, contribuant à son refroidissement.
Dans ces conditions le transfert d'énergie de la surface terrestre vers l'atmosphère par conduction, convection, et chaleur latente doit augmenter, contribuant ainsi à diminuer la température de surface. L'équilibre final de l'ensemble doit se trouver dans une diminution du gradient de température de l'atmosphère et de la température de la surface terrestre.
Le calcul de ce nouvel équilibre est un problème complexe. Rayonnement, atmosphère, conduction, convection sont couplés. Par exemple, on ne peut traiter séparément l'interaction entre rayonnement et atmosphère, la distribution de la température de l'atmosphère étant une inconnue du problème.
Mais, bien qu'il puisse paraître difficile, peut-être, d'en obtenir une évaluation chiffrée précise, une conclusion demeure : une augmentation de la concentration en dioxyde de carbone entraîne un refroidissement de l'atmosphère et de la surface terrestre.
Arguments scientifiques
La note précédente a pour but de dégager quelques notions essentielles sur le mécanisme des gaz dits à effet de serre. On s'est efforcé d'en faire une présentation aussi simple que possible. Mais, Il est peut-être utile, pour une meilleure compréhension de la note et pour étayer certains de ses arguments, de rappeler ici quelques notions de base. Là encore, la présentation simple qui en est faite néglige nombre de points de détail, mais sans en altérer les aspects fondamentaux.
Lire la suite...Les gaz à effet de serre
Les molécules de l'atmosphère, telles que la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, qui jouent un rôle actif dans l'effet de serre peuvent se trouver dans un « état excité » où elles sont le siège de mouvements oscillatoires complexes, à des fréquences définies, caractéristiques de chacun des types de molécules. Ces états d'excitation peuvent être provoqués par des chocs avec d'autres molécules de l'atmosphère, oxygène, azote, par exemple, mais aussi, par interaction avec un rayonnement électro- magnétique.
Le passage, à la fréquence \(\nu\) de l'état normal à l'état excité d'une molécule active se fait par absorption d'un quantum d'énergie h\(\nu\). Le passage de l'état excité à l'état normal se fait par émission d'un même quantum d'énergie.
Il peut y avoir, en fait, plusieurs niveaux d'excitation dont les énergies se mesurent en multiples d'un même quantum. Ainsi, une molécule de dioxyde de carbone, à la longueur d'onde de 15µ, présente des oscillations de déformation (la molécule linéaire O—C—O, subit des flexions transversales lorsqu'elle est excitée). Ces oscillations sont harmoniques : il leur correspond une suite d'états d'excitation d'énergie nhc/λ.
On se bornera dans la suite, pour la simplicité de l'exposé, à considérer que les molécules à effet de serre ne sont susceptibles que de deux états ; l'un normal, l'autre excité à un niveau d'énergie h\(\nu\).
Les chocs entre molécules concourent, dans un gaz, à l'établissement d'un équilibre thermique. Sous l'action de ces chocs, des molécules actives peuvent passer de l'état excité à l'état non excité, ou réciproquement, de l'état non excité à l'état excité. Cependant, à l'équilibre thermique, et en l'absence de tout autre type d'interaction, les nombres \(N_1\) et \(N_2\) respectivement, des molécules non excitées et des molécules excitées se trouvent, en moyenne, dans un rapport constant donné par la formule de Gibbs, où T est la température du gaz :
$$\frac{N_2}{N_1} = exp-\frac{h\nu}{kT}$$
Interaction avec un champ électromagnétique
Un rayonnement thermique peut être considéré comme formé d'un faisceau d'ondes électromagnétiques planes, ou d'éléments d'ondes planes, chacune d'elles caractérisée par sa direction dans l'espace, sa fréquence et l'énergie qu'elle transporte. A la fréquence ν, cette énergie se mesure en nombre de photons. La densité d'énergie est nhν et le flux d'énergie par unité de surface est cnhν où c est la vitesse de l'onde, égale à la vitesse de la lumière dans un gaz peu dense tel que l'atmosphère.
Dans l'étude de l'effet de serre, on s'intéresse tout particulièrement aux deux flux d'énergie thermique transportés par rayonnement électromagnétique, l'un, de la surface de la terre vers l'espace, l'autre, de l'espace vers la surface de la terre. Chacun de ces rayonnements résulte de la superposition d'ondes électromagnétiques élémentaires traversant l'atmosphère sous des incidences différentes et pour chacune des fréquences spécifiques des molécules des gaz à effet de serre.
Étudier l'interaction de ces rayonnements complexes revient à étudier, tout d'abord, l'interaction d'une onde élémentaire de direction donnée, à une fréquence de l'un des différents gaz.
Soit donc une onde électromagnétique plane traversant une couche « atmosphérique » comprenant, par unité de volume, \(N_1\) et \(N_2\) molécules non excitées et excitées, à la fréquence \(\nu\).
Le bilan de l'énergie échangée sur la distance dl peut s'exprimer, selon la mécanique quantique, par l'équation :
$$\frac{dn}{dl} = -K(N_1n-N_2n-N_2)$$
où \(n\) est le nombre de photons par unité de volume de l'onde.
Trois mécanismes élémentaires entrent en jeu.
- L'absorption, décrite par le premier terme du second membre de l'équation. Le champ électromagnétique cède des photons, de l'énergie d'excitation, à des molécules non excitées.
- L'émission stimulée, le deuxième terme de l'équation. Sous l'action du champ, des molécules excitées perdent leur énergie d'excitation en lui transmettant des photons.
- L'émission spontanée, décrite par le troisième terme. Des molécules excitées reviennent à l'état non excité, en cédant leur énergie au champ, indépendamment de l'énergie qu'il transporte déjà.
La constante K s'exprime en fonction des caractéristiques électriques propres des molécules. Elle mesure la force du couplage entre champ et molécules.
On observe que dans les questions concernant
le rayonnement thermique, (équ.1), la densité des molécules non excitées est
toujours supérieure à la densité des molécules excitées.
Par suite, on peut
utiliser un coefficient d'absorption nette toujours positif : \(\alpha=K(N_1-N_2)\)
L'interaction : Tendance à l'égalisation des températures
Supposons que le gaz est en équilibre thermique avec l'onde électromagnétique à la même température. L'échange d'énergie entre gaz et onde doit être nul, en moyenne. À partir de l'équation de Gibbs et de l'équation d'échange \(N_1n-N_2(n+1) = 0\) on obtient la densité de photons à l'équilibre thermique :
$$ \overline{n} = \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1} $$
C'est la valeur donnée par M. Planck dans sa théorie du corps noir. Elle ne dépend que de la fréquence et de la température.
La fonction \(\overline{n}(T)\) est monotone. \(n\) croît quand \(T\) croît. Par suite, on peut attribuer une température définie à toute onde transportant une densité de photons \(n\), et tout corps à cette température peut être considéré comme en équilibre thermique avec cette onde.
Les échanges d'énergie entre une onde transportant une densité n de photons et une couche atmosphérique à la température \(T\) sont donnés par l'équation de transfert radiatif local (2). En introduisant la densité d'équilibre de Planck (3), on peut donner à cette équation la forme simple :
$$\frac{dn}{dl} = -\alpha(n-\overline{n})$$
Son interprétation s'exprime en termes d'échange d'énergie, de quantité de chaleur, entre corps chaud et corps froid.
Une onde dont la densité de photons est inférieure à celle de Planck, dont la température est, par suite, inférieure à celle du gaz, absorbe de l'énergie ; elle refroidit le gaz en le traversant. Une onde dont la température est plus élevée que celle du gaz, le réchauffe, lui cède de l'énergie à son passage.
Dans les deux cas, on observe dans ces transferts de quantité de chaleur la tendance à l'égalisation des températures entre rayonnement et gaz qu'impose le deuxième principe de la Thermodynamique.
Les échanges entre rayonnement et gaz modifient donc les températures, et du rayonnement, et du gaz. La densité d'équilibre \(\overline{n}\) varie donc avec la température des molécules à effet de serre qui, elles-mêmes, sont couplées avec les autres molécules de l'atmosphère.
Pour simplifier les calculs de transfert d'énergie entre rayonnement et atmosphère, on suppose que la température locale de l'atmosphère n'est pas modifiée par l'interaction. Les résultats obtenus dans ces conditions montrent que le bilan des échanges par rayonnement est déficitaire : l'atmosphère fournit de l'énergie au rayonnement. On admet que la conduction thermique et la convection comblent ce déficit. Dans cette hypothèse, l'équation locale de transfert s'intègre immédiatement. On obtient :
$$n(l)-\overline{n} = (n(0)-\overline{n})exp-\alpha l $$
Cette équation exprime que la densité de photons transportés par l'onde tend vers la valeur d'équilibre de Planck au cours de sa traversée dans l'atmosphère. En d'autres termes, l'écart de température entre l'onde et l'atmosphère diminue lors de la progression de l'onde. Suivant le signe de l'écart, l'onde cède ou reçoit de l'énergie de l'atmosphère, la réchauffe ou la refroidit. Le coefficient d'absorption croit proportionnellement à la densité des gaz à effet de serre. L'égalité des températures entre atmosphère et onde est atteinte plus rapidement lorsque la densité des gaz à effet de serre est plus élevée.
La température des basses couches de l'atmosphère est peu différente de celle de la surface terrestre. Un rayonnement issu de la terre échange des photons par absorption et émission dans la traversée de ces basses couches, mais son contenu énergétique, son nombre de photons, reste peu modifié.
Si le nombre de photons transportés par une onde est beaucoup plus grand que le nombre de photons correspondant à la température du gaz, l'équation précédente prend la forme :
$$n(l) = n(0)exp-\alpha l $$
C'est à une équation de ce type que l'on fait référence pour ‘expliquer' l'effet de serre : « opacité de l'atmosphère » au rayonnement infra-rouge, « piégeage » du rayonnement émis par la surface de la terre.
L'équation de transfert radiatif « classique »
Un changement de l'ordre de ses termes, permet d'écrire l'équation de mise à l'équilibre (4) sous la forme :
$$n(l) = n(0)exp(-\alpha l) + \overline{n}(1-exp(-\alpha l)) $$
Elle met en évidence la loi de Kirchhoff, selon laquelle l'absorptivité est égale à l'émissivité, l'une et l'autre représentée par la quantité : \((1-exp-\alpha l)\)
Absorption et émission y sont nettement séparées ; ce qui donne lieu à l'interprétation des phénomènes de rayonnement infra-rouge, incorrecte du point de vue physique, déjà signalée dans le paragraphe précédent. Les écarts de température entre le rayonnement et la couche atmosphérique qu'il traverse restent peu importants, et l'émission ne peut pas être considérée comme négligeable en comparaison de l'absorption.
Par itération, sur des couches successives, on obtient :
$$ n(l) = n(0)e^{-\int_{0}^{l}\alpha(x)dx}+\int_{0}^{l}\alpha(x)\overline{n}(x,T)e^{-\int_{x'=x}^{l}\alpha(x')dx'}dx $$
\(n(x)\) y est la densité de photons de l'onde, et \(\alpha(x)\) l'atténuation nette en un point \(x\) de son parcours.
C'est une équation de transfert relative à une onde élémentaire de direction et de fréquences données. Elle peut être considérée comme formant l'ossature de l'équation de transfert radiatif classique.
Cependant, cette dernière ne se rapporte pas à une onde élémentaire unique, mais considère au contraire un rayonnement formé d'un faisceau d'ondes élémentaires. On passe d'une équation à l'autre par l'introduction d'un simple facteur multiplicatif. Le rappel qui suit développe ce point.
La description complète d'un champ électromagnétique dans un volume donné fait intervenir toutes les ondes élémentaires, les modes, susceptibles de se propager à l'intérieur de ce volume. On montre que, à une fréquence \(\nu\) donnée, et dans la bande de fréquence d\(\nu\), la densité de ces modes dans un volume V est égale à :
$$ pd\nu=\frac{8\pi\nu^{2}d\nu}{c^{3}} $$
Dans un angle solide d\(\Omega\) leur densité est
$$ p_\Omega d\Omega=2\frac{\nu^{2}}{c^{3}}d\Omega $$
Si l'on suppose que ces modes sont à une même température, ce qui est plausible lorsqu'il qu'il s'agit d'un rayonnement émis par un corps isotherme, le flux d'énergie transporté dans cet angle solide est :
$$ dI_\nu = 2\frac{nh\nu^{3}}{c^{2}}d\Omega $$
Il suffit de multiplier les deux membres de l'équation de transfert applicable à une onde élémentaire par le facteur \(\displaystyle 2\frac{h\nu^{3}}{c^{2}}\) pour retrouver l'équation de transfert radiatif classique.
Rayonnement d'un corps noir
L'énergie émise dans un élément d'angle solide, à la surface d'une couche atmosphérique, par un rayonnement en équilibre thermique avec elle à la fréquence v est donnée par la formule (10). Le flux total d'énergie émis perpendiculairement à la couche a pour expression :
$$ \Phi_\nu = 2\frac{h\nu^{3}n}{c^{2}}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}cos\theta .d\Omega_\theta $$
L'intégrale a pour valeur \(\pi\), \(n\) est défini par la relation (3) de Planck. Le rayonnement émis par un corps noir s'obtient par le calcul de l'intégrale \(\displaystyle \Phi = \int_{0}^{\infty}\Phi_\nu d\nu \)
D'où la formule de Stefan-Boltzmann : \(\displaystyle \Phi= \sigma .T^{4}\) avec \(\displaystyle \sigma = 5,67\cdot 10^{-8} W\cdot m^{-2} \)
Documents à télécharger
G. Convert - Synthèse (pdf) : cliquer ici.
G. Convert - Commentaires sur le climat (pdf) : cliquer ici.
G. Convert - Compléments scientifiques - inachevé (pdf) : cliquer ici.